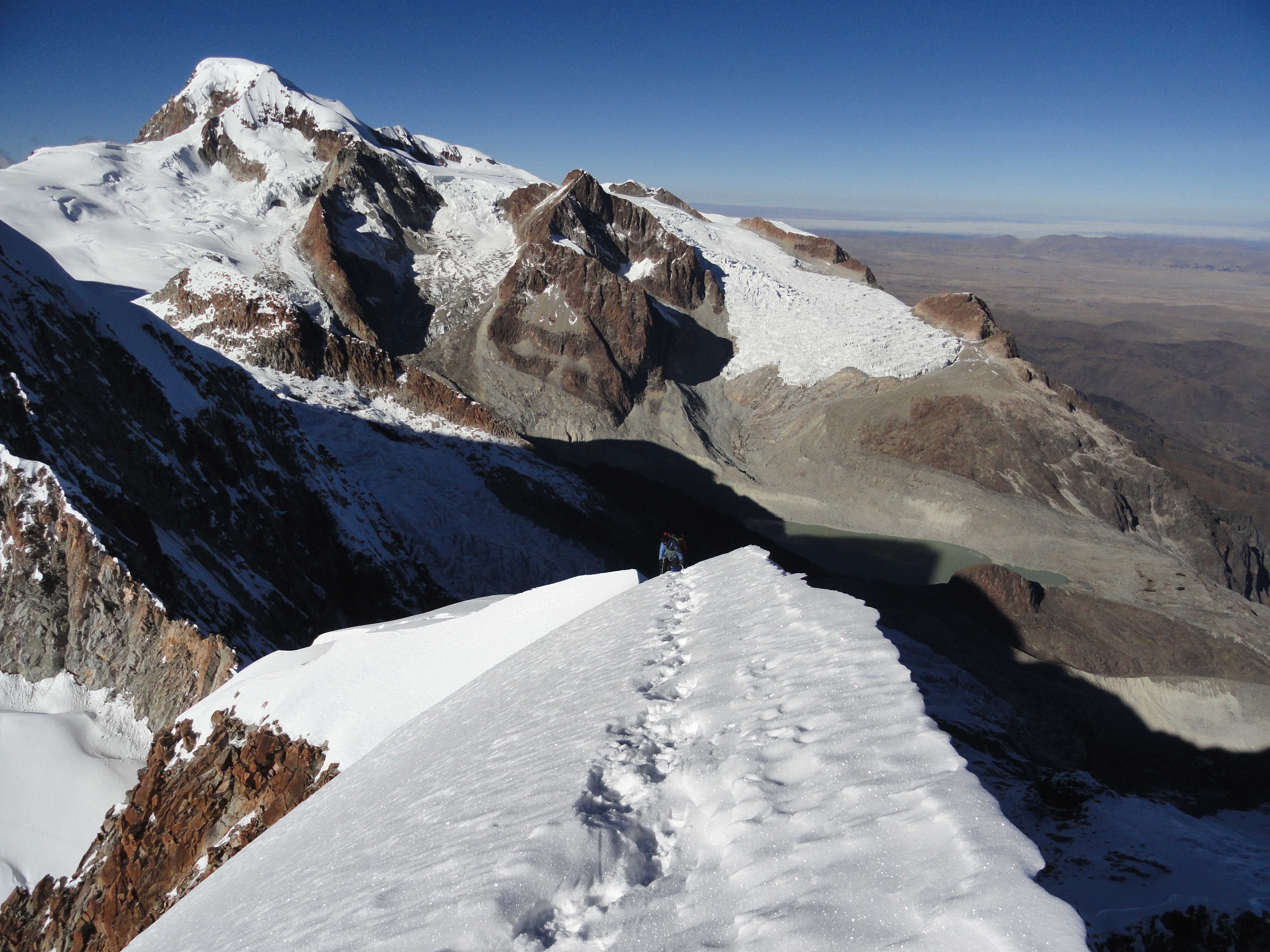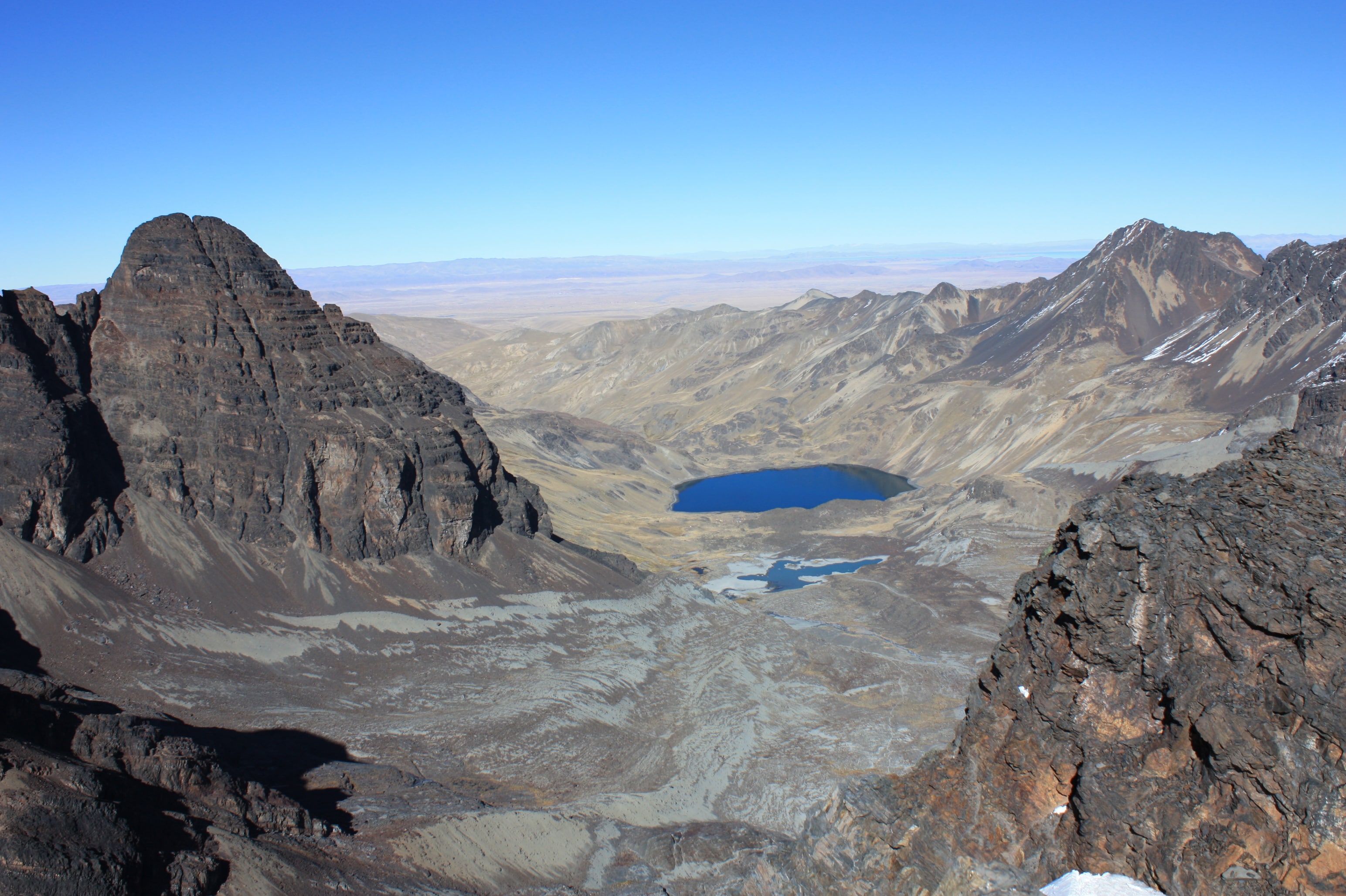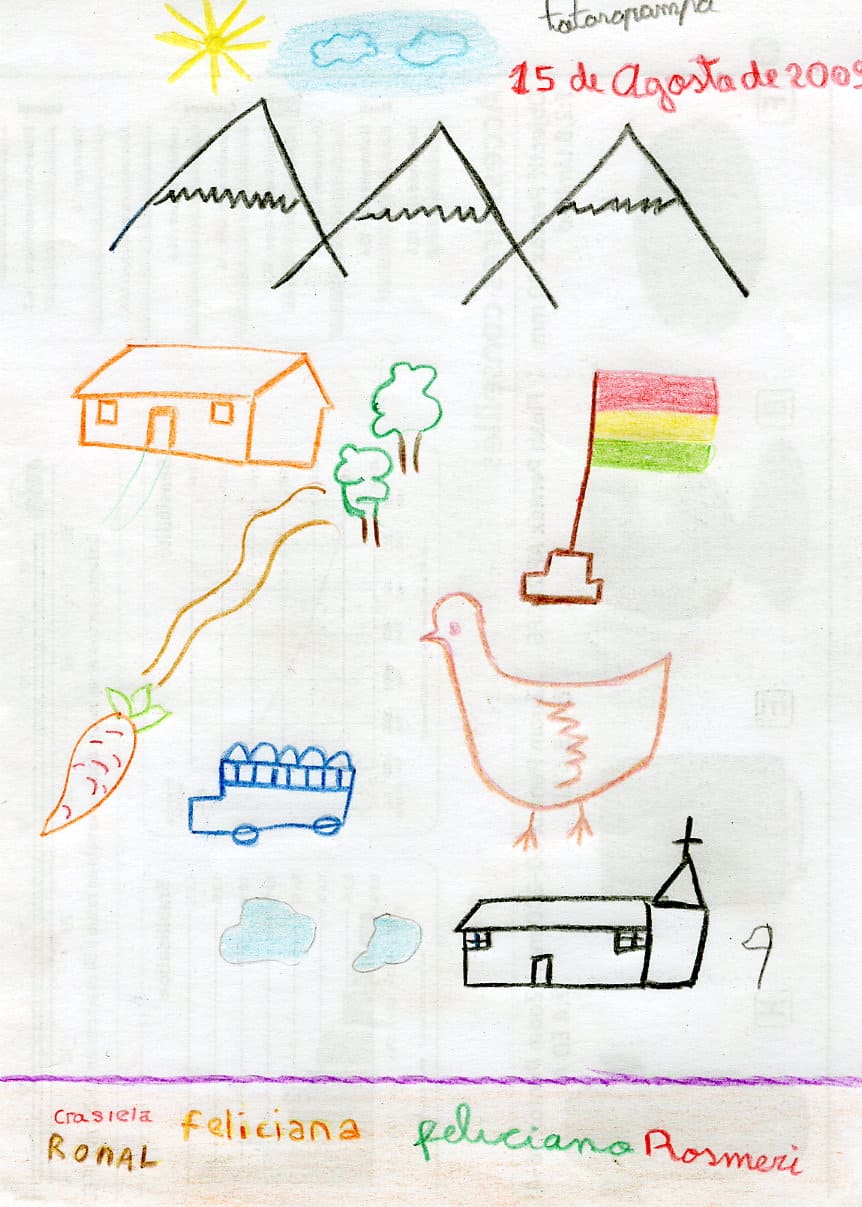Liste des sommets gravis
Illampu (6 368 m)
Pic Schulz (5 943 m)
Gorra de Hielo (5 740 m)
Pic del Norte (6 070 m)
Ancohuma (6 427 m)
Chachacomani (6 074 m)
Chearoco (6 127 m)
Janq'U Uyu (5 515 m)
Pach'a Pata (5 650 m)
Traversée du Pach'a Pata
Pyramide Blanche (5 230 m)
Pic Tarija (5 240 m)
Pequeno Alpamayo (5 410 m)
Tête du Condor (5 648 m)
Aile droite du Condor (5 480 m)
Huayna Potosi (6 088 m), voie normale
Huayna Potosi (6 088 m), voie des Français
Huayna Potosi (6 088 m), face ouest
Mururata (5 775 m), voie normale
Mururata (5 775 m), face sud
Illimani (6 439 m), voie normale
Layka Khollu (6 159 m)
Traversée intégrale de l'Illimani
Illimani (6 439 m), face sud, voie Espiritu del condor Gigante
Niveau
IV, TD, 65 à 70°
D, 55°, IV rocher
IV, D+, 80°, V rocher
IV, TD, 80°, IV-V rocher
IV, AD, 55°
III, PD, 40° à 45°
III, TD, 65° à 70°
I, F, 40°
III, AD+ ou D, 55°, III à IV
III, AD, 65° à 70°
II, AD, 45°
PD, 45°
II, AD, 45° à 50°
III, D, 70°
II, AD-, 45°
III, TD, 80°
II, AD+, 55° à 60°
II, D, 65° à 70°
IV, TD, 80°
IV, D, IV-V rocher
II, AD+, 50° à 55°
II, PD, 40°
IV, TD, 70°
IV, TD+, max 90°, VI rocher